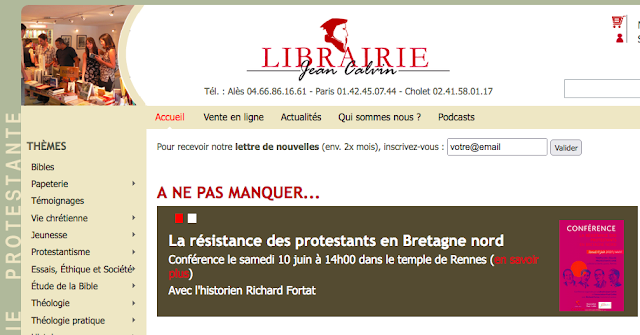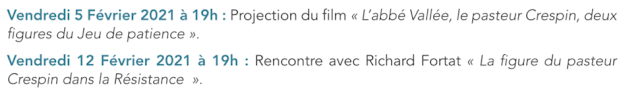CULTE D’ACTION DE GRÂCES
POUR PIERRE PRIGENT
Saint Matthieu
24 janvier 2025
Jean
11, 1-27
Chère famille de Pierre, chers amis de Pierre, chers
frères et sœurs en Jésus-Christ,
Pierre nous a quittés, comme dit la Bible,
« rassasié de jours », après un long pèlerinage terrestre, après une
vie riche d’amour donné et reçu.
Nous qui sommes éprouvés par le départ de Pierre, nous
qui sommes partagés entre une infinie tristesse, d’innombrables questions sur les
mystères de la vie et de la mort, et une profonde gratitude pour tout ce que
nous avons pu vivre avec lui, nous pouvons trouver dans ce texte de Jn 11, un
peu de réconfort et de consolation. Et pourtant, ce récit de la résurrection de
Lazare ne laisse pas d’intriguer. Et précisément Pierre se passionnait pour
toutes les aspérités des textes bibliques, pour toutes les questions que ces
textes posent autant qu’ils nous éclairent par leurs réponses. Lazare, l’ami de
Jésus, est malade, mais cette maladie n’est pas à la mort, et pourtant voilà
qu’il meurt bel et bien. Jésus apprenant que son ami est malade, ne se
précipite pas, il prend son temps, puis il annonce à ses disciples qu’il va le
réveiller – est-ce du sommeil ou de la mort ? – avant de leur dire
ouvertement : « Lazare est mort ». Et à Marthe sa sœur il
prophétise que son frère ressuscitera – mais est-ce au dernier jour, à la fin
des temps, ou aujourd’hui même ? Ce texte n’est qu’un tissu de quiproquos.
Oui, décidément, davantage de questions que de réponses, face à la mort comme
face à la vie. Et enfin, cette parole de Jésus, magistrale, souveraine : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais ». Mais cette parole de foi et d’espérance
ne l’empêche pas de pleurer, car Jésus pleure, comme nous en ce moment, et ses
larmes rejoignent les nôtres, comme nos larmes se mêlent aux siennes. Jésus
nous précède sur ce chemin où l’infinie tristesse se conjugue à l’espérance.
Jésus se présente lui-même comme « la
résurrection et la vie ». La vie, oui, mais quelle vie ? La
résurrection, oui, mais laquelle ? On sait que, dans les textes
évangéliques, il y a quatre cas de figure parmi tous les récits de
résurrection. Il y a tout d’abord les personnes qui se réveillent de la mort
alors qu’elles sont décédées depuis peu de temps. Nous les voyons se
réveiller comme d’un sommeil, et se lever pour reprendre le cours interrompu de
leur vie habituelle, comme si leur mort n’était qu’une parenthèse à présent
refermée. Ainsi, Jésus « rend à sa mère » le jeune homme de Naïn
qu’il vient de « réveiller » (Lc 7, 14-15). Jaïrus, quant à lui,
retrouve sa fille vivante comme si elle avait « dormi » et venait
seulement de « se réveiller » et de « se lever » (Mc 5,
39-42). Enfin, Lazare, notre cher Lazare, est « réveillé » par Jésus
après quatre jours dans son tombeau, et alors qu’il « sent » déjà,
dit crûment notre texte (Jn 11, 39 ; 12, 1). Bien entendu, ces trois-là
mourront de nouveau un jour.
La seconde situation concerne les personnes mortes
depuis longtemps. Les évangiles nous
disent que les gens croyaient voir en Jésus un ancien prophète revenu à la
vie : Elie, Jérémie, Jean-Baptiste ou encore un autre (Mt 16, 14 ; Lc
9, 7-8+19). Quelques commentateurs discernent dans ce cas de figure la mention
d’une nouvelle incarnation, puisqu’il y a eu mort (de l’un des prophètes) puis,
longtemps après, naissance (de Jésus). Cela est contestable au sujet de
Jean-Baptiste (né quelques mois avant Jésus), mais surtout cette interprétation
de certains de ses contemporains est infirmée par Jésus lui-même, qui loue ses
disciples pour ne pas croire ce que les autres disent de lui (Mt 16,
17-20 ; Lc 9, 21) : la réincarnation semble incompatible avec la
résurrection, comprise comme réveil et remise en route de la même personne
singulière.
La troisième situation est celle de Jésus lui-même. Son cas est unique et son corps de résurrection est
décrit comme très différent des précédents. On ne le reconnaît pas toujours (Lc
24, 16+37 ; Jn 20, 14) ; il passe à travers les murs (Lc 24,
36) ; il apparaît ou disparaît à volonté (Mc 16, 9-14 ; Lc 24, 31).
Il est reconnu lorsqu’il montre ses plaies (Lc 24, 39-40 ; Jn 20, 27) et
surtout lorsqu’il appelle ceux qu’il aime par leur nom (Jn 20, 16). Il vit
quelques temps d’une façon normale, mangeant et dormant, mais il s’élève
ensuite auprès de son Père céleste (Lc 24, 51 ; Ac 1, 9). Manifestement,
la résurrection du Christ est d’un autre ordre que celle des hommes : il
s’agit d’une transformation radicale qui met un terme à l’Incarnation
provisoire du Dieu éternel, qui n’a connu la mort que pour mieux triompher de
son pouvoir. L’événement de Pâques est l’expression la plus paradoxale de
l’entrée de l’éternité dans le temps.
Enfin, la quatrième situation concerne la résurrection
future promise aux croyants fidèles.
Les textes qui en parlent sont loin d’être clairs, mais ils laissent entendre
qu’elle sera soudaine et ne passera pas par une naissance mais par une
transformation très profonde, comme celle de Jésus, qui leur donnera accès à la
vie éternelle (1 Co 15, 51-52). Ce changement radical interviendra pour ceux
« qui appartiennent au Christ », au moment de son retour (Mt 24,
31 ; 1 Co 15, 23), même s’ils sont encore vivants (1 Th 4, 15). Mais que
sera-t-elle précisément, cette résurrection à venir à la fin des temps ? Nous
ne pouvons le savoir, mais seulement l’attendre dans la confiance et
l’espérance dans les promesses de Dieu.
Le dossier de la résurrection est donc tout sauf
simple, et Lazare n’est qu’un cas très particulier de résurrection. Mais c’est
à l’occasion de cette résurrection-là que Jésus promet à ceux qui croient en
lui la vie, en dépit de la mort. La vie est promise malgré la mort. Quelle est
donc cette vie qui traverse la mort ? Ce texte de Jn 11 fait écho à un
autre texte de Jn, quelques chapitres auparavant, en Jn 5, 24. Voici ce que dit
Jésus : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute
ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ». Étrange
formule, ce passage de la mort à la vie. D’ordinaire, selon notre logique,
c’est la mort qui succède à la vie, alors qu’ici elle la précède. C’est bien
qu’il y a au moins deux types de vie, et deux types de mort : la vie
biologique, physico-chimique (ὁ βίος dans le grec du Nouveau Testament), et la
vie éternelle, la vie en abondance (ᾑ ζωή αἰῴνιον), de même qu’il y a la mort
biologique, et la mort spirituelle. La vie biologique peut très bien se
combiner avec une mort spirituelle, c’est-à-dire avec une vie sans Dieu. Et la
vie éternelle peut surgir au creux de cette mort-là, dès lors que nous nous
tournons vers Dieu, pour lui faire de la place dans notre vie. Et ainsi la vie
éternelle, la vie en abondance peut accompagner la vie biologique, la doubler en
quelque sorte, puis la prolonger, la relayer dans la mort biologique. C’est
ainsi que « celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait
mort », selon la parole de Jésus à Marthe en Jn 11. Ainsi Lazare
est-il passé de la mort physique et spirituelle à la vie éternelle, qui se
prolongera au-delà de sa seconde mort physique, celle qui surviendra un jour
prochain, et qui ne nous est pas racontée dans ce récit.
J’ai trouvé un commentaire particulièrement éclairant
de ce texte de Jn 11. Je vais vous en faire lecture : « Voilà ce que
proclame la résurrection de Lazare aux hommes de tous les temps et de tous les
pays. Reste la seule question qui peut faire de chacun un nouveau Lazare :
“Crois-tu cela ?” (v. 26). C’est la seule condition qui permet de connaître
dès à présent, avant la fin des temps, une vie qui ne dépend plus de la seule
nature mais expérimente déjà ce que l’éternité de Dieu promet. (…) Le judaïsme
de tendance pharisienne croit à une résurrection générale à la veille du
jugement dernier. La réponse de Jésus bouleverse ce cadre temporel : il
est lui-même l’anticipation de la fin. Le jugement est déjà à l’œuvre. Avec le
Christ les chrétiens connaissent la résurrection et expérimentent donc la
réalité d’une vie qui ne peut être interrompue par l’anéantissement du corps.
C’est une réalité présente et qu’on peut donc vérifier, mais seule la foi
permet d’y accéder. C’est pourquoi Jésus poursuit : “Crois-tu
cela ?” » Fin de citation. Quel est
donc l’auteur de ce commentaire de Jn 11 que j’affectionne tout
particulièrement ? Il s’agit tout simplement de Pierre Prigent, dans son
livre intitulé : Heureux celui qui croit. Lecture de l’évangile selon
Jean. C’est ainsi que Pierre nous invite à répondre à la question qui
permet de faire de chacune et de chacun d’entre nous, aujourd’hui, un
nouveau Lazare, ou une nouvelle Marthe : « Crois-tu
cela ? » Petit clin d’œil aux engagements œcuméniques de Pierre,
puisque cette formule de Jésus : « Crois-tu cela ? » a été
retenue pour mot d’ordre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens que
nous vivons précisément en ce moment.
La dernière fois que j’ai visité Pierre, visite qui avait entre autres pour objet de préparer
la célébration d’action de grâces de ce jour, Pierre m’a dit notamment deux
choses que je retiens et que je garderai toujours. Il m’a dit tout d’abord
qu’il souhaitait que ce soit sur ce texte de Jn 11 que porte la prédication
d’aujourd’hui. Et il m’a raconté combien ce récit l’avait nourri au cours de sa
vie de foi, et notamment cette parole de Jésus : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait
mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Et combien
il tenait à ce que cette parole soit prêchée en témoignage de son espérance. Pierre,
en virtuose de la transmission, en personne si attachée au passage de relais
théologique et spirituel, au passage de témoin à proprement parler, dans tous
les sens du terme, Pierre voulait à tout prix laisser cette parole de Jésus à
nous toutes et tous qui lui survivront. Amoureux de la transmission, à laquelle
il a voué sa vie, pour laquelle il a enseigné si longtemps et écrit tant de
livres, dont le dernier paraîtra encore tout prochainement, Pierre voulait
témoigner jusqu’à son dernier souffle, et encore après son départ lors de la
célébration d’aujourd’hui.
Mais Pierre m’a dit une deuxième chose lors de
cette ultime rencontre, et une chose qui pourrait sembler, à première vue,
contredire la parole de Jésus, en tout cas qui entretient avec elle une tension
paradoxale. Pierre m’a dit : « Je n’ai pas la religion de la
vie ». Je n’ai pas la religion de la vie… Cette formule, et la tension
proprement dialectique qu’elle donne à voir avec la parole de Jésus : « Je
suis la résurrection et la vie », m’ont longtemps travaillé ces
dernières semaines. Je les ai réfléchies avec ma tête, je les ai méditées avec
mon cœur, j’ai cherché à les articuler, et voici ce que je peux peut-être
balbutier devant vous pour vous présenter, pour vous offrir ce que j’ai reçu de
Pierre. Son plus beau cadeau en ce qui me concerne.
« Je n’ai pas la religion de la vie ». Il s’agit bien entendu de la vie biologique, et non de
la vie éternelle. Cette vie biologique, il ne s’agit pas de la sacraliser, de
l’absolutiser, d’en faire une idole. Mais alors, si la vie biologique n’est pas
sacrée, qu’est-ce qui est plus important que la vie ? Je ne vois qu’une
seule réponse : le plus important, c’est l’amour. L’amour est plus
important que la vie. Pierre aurait pu dire : « J’ai la religion
de l’amour ». J’en veux pour preuve ce que j’ai lu de lui :
lorsque Pierre a écrit son livre sur Origène et Marcion, il se disait frappé
par les velléités des chrétiens à exclure, à condamner, à excommunier, alors
même qu’ils vivent d’une religion de l’amour. J’en veux aussi pour preuve ce
que j’ai entendu de lui, chaque fois que je l’ai écouté prêcher, et notamment
ici à Saint Matthieu : l’amour est la seule chose qui donne sens à la vie,
mais paradoxalement, l’amour transcende la vie. Il y a d’ailleurs des textes
bibliques qui le disent. On pensera sans doute d’abord à ce verset du Cantique
des cantiques : « L’amour est fort comme la mort » (Ct 8, 6). On
traduit parfois à tort : « l’amour est plus fort que la mort »,
mais il s’agit plutôt de comparer la force de l’amour à la force de la mort, et
de voir par conséquent la puissance de l’amour, à une époque où, la foi en la
résurrection n’étant pas encore présente, la mort l’emportait sur la vie. Et
l’amour, sans l’emporter sur la mort, rivalisait avec elle. Mais c’est surtout
un verset du Psaume 63 qu’il faut retenir : « Ta bonté vaut mieux que
la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges ». Ta bonté vaut mieux que
la vie : « Tov hasderah méhayîm », en hébreu. Il ne s’agit pas à
proprement parler de l’amour, mais d’un terme très proche :
« hésèd », c’est la bonté, la grâce, la miséricorde, la
bienveillance, la tendresse. L’amour et la tendresse de Dieu valent mieux que
la vie : qu’est-ce à dire ?
Eh bien, nous pouvons comprendre ceci : dans la
vie comme dans la mort, l’essentiel est d’être dans l’amour, c’est-à-dire
d’être en communion avec Dieu. La première épître de Jean nous dit que
« Dieu est amour » (1Jn 4, 8+16). Elle nous le dit à deux
reprises : « Dieu est amour ». Si Dieu est amour, c’est que
l’amour n’est pas seulement un attribut de Dieu comme un autre, Dieu n’est pas
seulement aimant, il est amour, il s’identifie à l’amour, il n’y a donc pas de
différence entre Dieu et l’amour, l’amour est l’identité même de Dieu, l’amour
est le nom de Dieu, ou l’un de ses noms, on dirait aujourd’hui qu’il est son
ADN. Si nous sommes touchés, affectés, bouleversés, affligés même par la mort
d’un proche, comme aujourd’hui avec le départ de Pierre, c’est parce que la
mort est une rupture de lien. Oui, la mort est une rupture de lien. Mais en
réalité, plus fondamentalement, au-delà des apparences, au cœur même du
mystère de la mort, le lien n’est pas rompu, le lien est maintenu,
le lien en tant que tel ne meurt jamais, car le lien d’amour, c’est Dieu
lui-même. Cette relation d’amour qui nous vient du Dieu dont l’identité est
l’amour, c’est ce que l’on appelle à juste titre la communion des saints. Dans
la vie comme dans la mort, nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes au
bénéfice d’un amour qui transcende et la vie et la mort. Nous qui sommes encore
pour un peu de temps dans la vie terrestre, mais dès aujourd’hui appelés à
entrer par la foi dans la vie éternelle, nous pouvons trouver consolation et
réconfort dans cette conviction : partagés entre notre tristesse infinie,
nos questions sur les mystères de la vie et de la mort, et notre gratitude pour
tout ce que nous avons pu vivre avec Pierre, pour tout ce que Pierre nous a
donné, et pour tout ce que Dieu nous a donné à travers lui, nous croyons que nous
sommes portés par un Dieu d’amour qui nous garde dans l’amour, un amour qui
déborde, qui excède toutes nos mesures humaines, toutes nos mesures trop
humaines.
Amen.











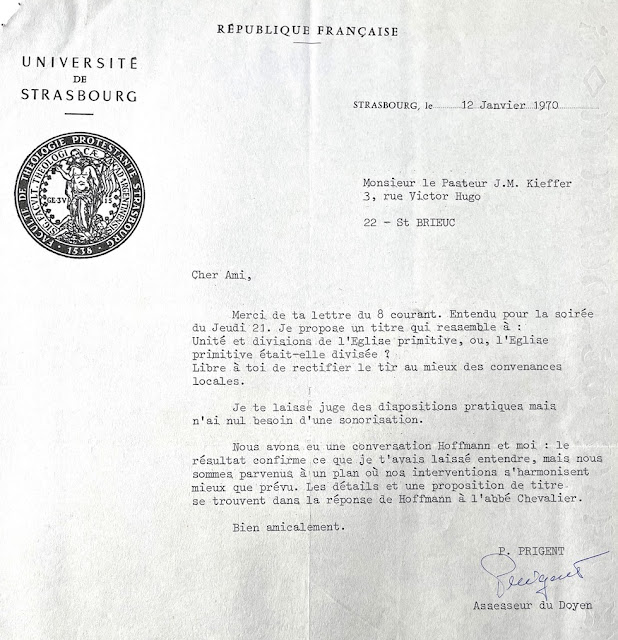

.JPG)