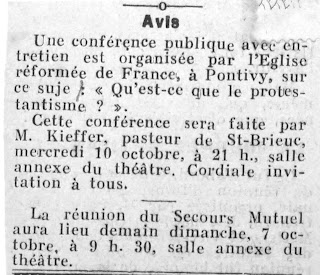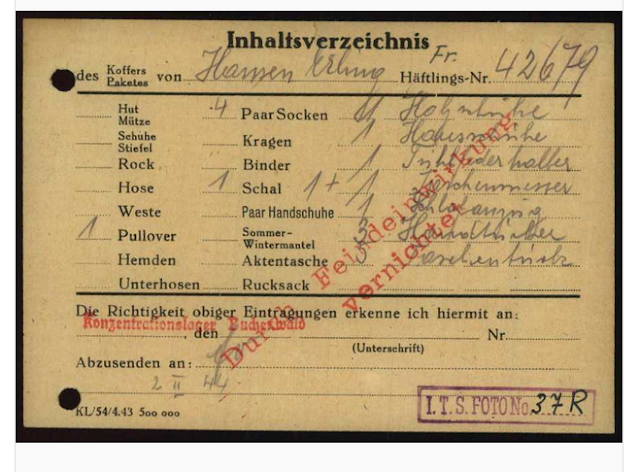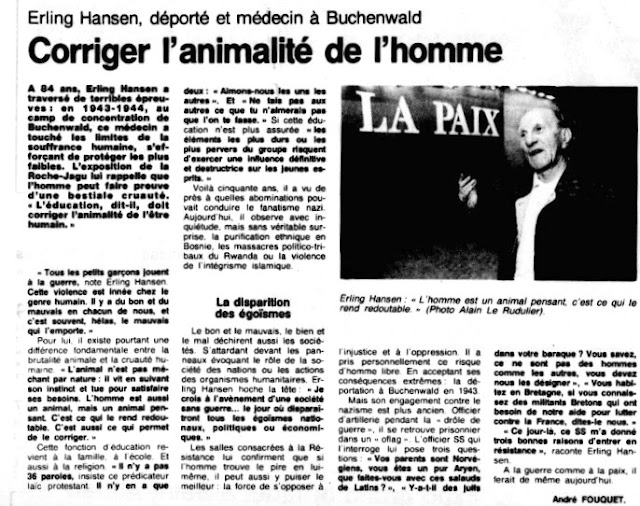A Saint-Brieuc
Suivant
la voie tracée dans sa famille (fils d'Oscar Hansen, co-fondateur de la
première association cultuelle protestante en 1906), il participe
activement à la vie de cette église. En 1929, l’assemblée générale de l’Église méthodiste va l'élire conseiller presbytéral pour la première
fois à l’âge de 20
ans. Il fait partie du bureau du conseil à partir du 5 février 1938
comme trésorier. De 1938 à 1940 il assure
aussi le secrétariat du conseil presbytéral. Après ses années de déportation il restera membre du conseil presbytéral jusqu'en 1987.
Erling se marie à Maïe (Marie-Josephe Le Gouard, selon son état civil) le 4 juin 1938 à Saint-Brieuc.
 |
29 Juin 1938 annonce de mariage Hansen. Ouest-France
|
Léna va naître le 17 décembre 1941.
 |
Annonce parue le 22 décembre 1941 dans Ouest-Eclair
|
Les membres de la communauté de St Brieuc connaitront leur fille Léna, née en 1941 (mariée avec Jean-Louis Saccardy) et leur fils Yann, né en 1943.
 |
Erling Hansen en 1931 au Légué (22 ans) |
L'accueil des réfugiés espagnols
On sait peu de choses sur l'aide apportée par Erling Hansen dans le cadre du Comité qui avait été créé par Louis Guilloux au moment de l'arrivée des réfugiés espagnols à Saint-Brieuc avant la Guerre 39-45.
Le pasteur Crespin y figurait en bonne place au nom de la communauté protestante, mobilisée sur le sujet.
Un document d'archives mentionne Erling Hansen, comme médecin (en tant qu'interne ou déjà installé?) étant autorisé à se trouver sur le quai de la gare de Saint-Brieuc juste au moment de l'arrivée des trains.
Ces rares personnes, le plus souvent responsables d'associations, étaient munies d'un laissez-passer.
 |
Document 27 mai 1938. Archives départementales.
|
La Guerre 39-45
Erling Hansen est déjà médecin quand commence la Seconde guerre mondiale. Il est mobilisé le 25 août 1939 comme médecin-lieutenant dans le 109e Régiment
d'artillerie lourde de Châteaudun.
Son régiment part dans le Nord-est de la France, dans un secteur proche de la Ligne Maginot et du Luxembourg. Les
Allemands attaquent, prennent vite le dessus et avec ses camarades ils sont capturés puis envoyés dans un camp de prisonniers, l'Oflag VI D, à Münster, en Westphalie.
 |
Mai 1940, départ pour le Front. Daniel Manac'h prend la photo.
Einar, Solveig, Thorleif, Erling Hansen. Photo Solveig Hansen |
 |
Mai 1940, départ pour le Front. Daniel Manac'h prend la photo.
Famille Hansen et Manac'h. Photo Solveig Hansen |
 |
| Un cousin norvégien, Solveig, Einar, Oscar, Anna, Erling et devant, Thorleif. Photo Solveig Hansen. |
Engagement
Ce témoignage figure page 626 dans le livre " Les protestants pendant la
seconde guerre mondiale, actes du colloque de Paris 1992.
Supplément au
Bulletin de l’histoire du protestantisme français, n°3 juillet, août, septembre
1994. Textes réunis par André Encrevé et Jacques Poujol".
"Je voudrais d'abord vous dire comment
naquit ma résistance. J'étais médecin-lieutenant dans le 109e Régiment
d'artillerie lourde de Châteaudun. Les plus gros canons tractés par des chevaux
(20 chevaux par canon), nous sommes tranquillement montés jusqu'à l'extrémité
de la Ligne Maginot et du Luxembourg, et là on s'enterra à moitié. Les
Allemands ayant pris l'initiative, il a fallu redescendre, et nous avons été
capturés dans le bois de Nancy, au Bois de Haye, puis envoyés prisonniers. Je
fus envoyé dans l'Oflag 6D, à Münster, en Westphalie.
Nous étions mille officiers, environ 150
médecins, 50 protestants. Nous n'avions pas de pasteur et deux ou trois laïcs
faisaient le culte le dimanche, comme ils pouvaient, bien maladroitement.
Au
bout de quelques mois vint l'ancien directeur des missions protestantes de
Paris, le pasteur Émile Schloesing (biogaphie ici). Nous eûmes à partir de ce moment-là des
sermons formidables que ma mémoire me permettait de transcrire presque
intégralement chaque après-midi. J'écrivais à ma femme : "Grâce à lui, le
moral est bon". Puis un jour je fus convoqué par le commandant de la
Gestapo du camp : "Vous n'avez pas un nom français", me dit-il.
"Non, je suis d'origine norvégienne", lui dis-je. "Ah, ah, de
père ou de mère?". "De père et de mère". "Alors, me dit-il
en colère, comment se fait-il que vous, pur aryen, vous soyez avec ces salauds
de latins?".
Il poursuivit en critiquant la France et les Français, mais
s'il croyait me convertir il faisait fausse route. "Connaissez-vous des
juifs?", me demanda-t-il . J'en connaissais : il y en avait deux dans mon
régiment. Mais j'ai franchement menti, nettement, sans hésitation, en disant
"Non!". C'est alors qu'il reprit : "Si par hasard vous en
rencontrez, veuillez nous donner noms et adresses, parce que, voyez-vous, nous
avons des camps spéciaux pour eux"... Deuxième raison pour faire de la
résistance ! Puis il me dit :"Vous êtes de Saint Brieuc? Dans les
Côtes-du-Nord?. "Oui", lui dis-je. "Alors vous connaissez des
Bretons, des Bretons parlant breton... Voyez-vous, nous savons que certains
Bretons se plaignent de la France. Alors nous avons l'intention de les
convoquer et de leur expliquer que, dans certaines conditions, ils seront
libérés avant les autres" !.
Voilà, les trois raisons de ma résistance :
en une demi-heure, ce SS m'avait converti à la Résistance.
Lien pour accéder à un article sur le
parcours du Dr Hansen dans les camps
Résistance
De retour du camp où il était prisonnier, Erling Hansen reprend ses activités comme médecin place Saint-Michel à Saint-Brieuc, dans une ville occupée depuis le 27 janvier 1941. Il exerce aussi comme médecin scolaire et médecin de travail, ce qui l'amène à connaitre de nombreux secteurs et à beaucoup circuler.
Mais Erling Hansen est membre actif d'un réseau de résistance où se trouve aussi le pasteur Crespin. Ils effectuent des émissions de radio clandestines.
 |
Mars 1941 au Légué, Erling avec son épouse. Photo famille Hansen
|
En tant que médecin, Erling Hansen n'hésite pas à fournir de faux certificats médicaux pour que des jeunes gens soient dispensés d'une affectation en Allemagne dans le cadre du Service du Travail Obligatoire (S.T.O). Mais toutes ces activités sont regardées par la police allemande, informée par des indicateurs.
Arrestation et déportation
Erling Hansen est arrêté par la Gestapo en novembre 1943 en même temps que le pasteur Crespin et d'autres membres de la paroisse. Il est emprisonné à St Brieuc puis à Rennes et déporté à Buchenwald puis Mühlausen.
 |
| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |
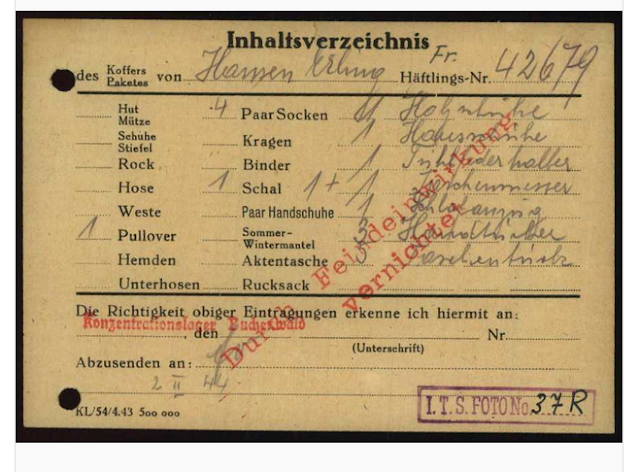 |
| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |
 |
| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |
 |
| Fiche Erling Hansen. Base de données Arolsen. |
Erling parvient à réchapper à l'enfer des camps en avril 45, mais en plus son action aura permis de sauver de nombreuses vies.
La
lecture de ses mémoires fait apparaitre l'importance de sa famille et
de sa foi protestante. Erling Hansen a pu se procurer du papier dans le
camp et écrit au jour le jour. Pour bien comprendre le texte qui suit,
Erling Hansen utilise le "nous" pour dire "je".
8
octobre 1944 : "Nous pensons aussi bien sûr à toute notre famille, à
tous nos amis de St Brieuc, à tous ceux qui, ce matin, ont prié pour
nous au Temple"
14 mars 1945 : "Commencé la rédaction
de ma causerie sur le Protestantisme. Nous regardons les photos que nous
avons de Maïe et des enfants. Nous le faisons souvent...mais nous
n'avons pas voulu en parler encore. Nous les avons reçu dans un des
colis!"
Jeudi 22 mars 1945 : "Pensé à l'anniversaire
d'Einar"... "Le soir, fait une causerie aux malades sur
conception-hérédité, comment se perpétue notre vie"
Lundi 26 mars 1945 : "Nous avons commencé à écrire une étude sur "Qu'est-ce que le christianisme?
Pourquoi la Réformation au 15ème siècle? Comment croire?"
De retour des camps après-guerre
Revenu à Saint-Brieuc, après le départ du pasteur Vidal, il
débute dès 1946 comme prédicateur laïc et le 10 février le
conseil l’appelle à sa vice-présidence. A partir de 1947 il
assure les fonctions de trésorier de la Société d’Évangélisation
de Bretagne qui regroupe les églises de Saint-Servan-Saint-Malo,
Saint-Brieuc, Lannion-Perros-Guirec, Brest-Quimper, Lorient et
Vannes.
Il exerce différentes responsabilités et conduit le culte
le dimanche quand cela est nécessaire, rédigeant lui-même ses
prédications.
En dehors de son engagement protestant, Erling Hansen est une figure importante de la Résistance. Il reçoit la Légion d'honneur en 1952 des mains de René Pléven, alors Ministre de la Défense nationale.
Le journal Ouest-France rend compte de cette cérémonie, avec beaucoup de détails, dans son édition du 19 mai 1952.
Aux côtés du ministre, on trouve notamment M. Fleury, le préfet, MM Le Cozannet et Maziers, députés, M. Jézéquel, sénateur, M. Nicolas, maire de Saint-Brieuc, le Pasteur Marquer, l'abbé Barré, l'abbé Chéruel, tous les présidents d'associations de déportés et de Résistants.
René Pléven a tenu à montrer dans son discours que très souvent, la Légion d'Honneur était décernée à des personnes ayant accompli des actions d'éclat mais "en ce qui concerne le docteur Hansen, il s'agit d'une action d'éclat qui a duré plus d'une année, et dont chaque seconde a exigé un courage et une abnégation auxquels on ne saurait que rendre hommage."
"Erling Hansen est un des meilleurs français parmi les français"
René Pléven
Lors de cette cérémonie, le docteur Hansen demanda à chacun "de garder le souvenir de ceux qui sont morts loin pour leur pays, et de rechercher toujours ce qui, au delà des opinions diverses, peut nous unir.
Évoquant les honneurs dont il était l'objet lors de cette cérémonie, il en reporta modestement tout le prix sur la formation humaine et religieuse que lui avaient donnée ses parents et qui fut toujours son soutien le plus efficace et le plus puissant".
Erling Hansen restera membre
du conseil presbytéral jusqu’en 1987, après 47 ans de présence. Il aura oeuvré pendant cette longue période auprès de sept pasteurs.
Maïe, son épouse, décède en 1994 à St Brieuc.
Inlassablement, le docteur Hansen intervient lors de colloques, de conférences. A La Roche Jagu en 1994, il va porter une parole de Paix :
"L'éducation doit corriger l'animalité de l'être humain"
Erling Hansen
Toujours en 1994, le 13 juin, le journal Ouest-France rend hommage à Erling Hansen dans un article :
Leur médecin
briochin les avait tous maintenus en vie
Retrouvailles d'anciens de Buchenwald
Des anciens déportés des kommandos Schonebeck et Mülhausen du camp de
concentration de Buchenwald se sont retrouvés samedi à Plérin, autour du
médecin du kommando de Mülhausen, Erling Hansen.
Avec les veuves, ils étaient 91 à Plérin, dont la moitié d'anciens déportés.
Anciens des kommandos de Schonebeck (1 200 déportés) et Mülhausen (600
déportés). Voilà 25 ans qu'ils ont pris l'habitude de se retrouver pour
échanger leurs souvenirs, penser à leurs camarades morts, resserrer les liens
de solidarité qui leur ont permis de survivre. Venus de toute la France, c'est
la 2e fois (la 1re, c'était en 1980) qu'ils choisissent Plérin, la ville natale
du médecin briochin Erling Hansen.
Arrivé à Buchenwald en janvier 1944, Hansen
a été nommé médecin du kommando Martha, celui de Mülhausen : 600 hommes qui
travaillaient dans une usine Junker. Outre Erling Hansen, plusieurs habitants
des Côtes-du-Nord étaient de ce kommando. Le Plérinais François Jegou, arrêté à
Maël-Carhaix en août 1943, qui arriva à Buchenwald après un court crochet par
Auschwitz, se souvient notamment d'Albert Hellien, plus tard maire de Lanrodec.
« Il y avait aussi un Briochin, Fromentin, mais je ne l'ai pas beaucoup connu.
» Erling Hansen, lui, en, garde un souvenir net : « Il était boxeur et un peu
masseur. Le directeur de l'usine où travaillait le kommando souffrait de
crampes. Je lui ai conseillé Fromentin ». Après le premier massage, « il ne
pouvait plus marcher. Il était furieux. J'ai dit à Fromentin d'y aller plus
doucement. Et pendant un mois, ça lui a fait une soupe supplémentaire ».
Erling
Hansen a pu maintenir en vie ses 600 kommandos jusqu'
à la libération du camp :
« Un cas unique », dont il est fier. « J'ai eu une chance », celui d'être sous
la surveillance du SS Friedrich Hartz, un instituteur de 46 ans, entraîné
contre son gré dans la tourmente nazi, qui fit tout ce qui était en son pouvoir
pour aider les déportés :
« A mon retour, tout le monde était contre les
Allemands, et c'était bien normal, se souvient Erling Hansen. Mais je peux en
témoigner, sans lui nous ne serions pas tous rentrés ».
En 1996, on le retrouve à la une de la presse locale pour la cérémonie aux lycéens martyrs de l'ancien Lycée Le Braz. Chaque année, c'est une cérémonie qu'il ne manque pour rien au monde.
 |
Ouest-France, 11 décembre 1996
|
La presse locale ne manque pas une occasion de donner des nouvelles du docteur Hansen comme en 1998, dans un reportage sur la rue Chateaubriand dans le quartier Saint-Michel où Erling Hansen coule des jours tranquilles.
En
1999, avec André de Kerpezdron, il entreprend à l'âge de 90 ans de
retracer l'histoire de la communauté protestante de Saint-Brieuc-Perros et
d'en faire un album, comme on fait un album de famille. Il recontacte
d'anciens pasteurs disséminés au quatre coins de la France, fait appel à
ses souvenirs, consulte des archives...
 |
1999, 15 avril Ouest-France
|
La disparition d'Erling Hansen
Le docteur Erling Hansen décède le 27 mars 2008, à
près de cent ans. Cette nouvelle attriste de très nombreuses personnes car c'est un homme connu et estimé.
La presse retrace les grandes étapes de sa vie.
 |
29 mars 2008. Ouest-France
|
Texte intégral de l'article du
29 mars 2008 présenté ci-dessus
Né
au Légué, de parents norvégiens, ancien élève du lycée Le Braz, de 1921 à 1929,
et docteur en médecine, il exerçait place Saint-Michel où il fut arrêté sur
dénonciation, le 2 novembre 1943. Résistant dans l'armée secrète du commandant
Armand Vallée et brutalisé par la Gestapo après son arrestation, il est déporté
à Buchenwald.
Couvert
par son nom d'origine germanique et bénéficiant de son statut professionnel,
Erling Hansen s'est aussitôt mis à la disposition des détenus, dont il partagea
le sort inhumain. « Ma grande satisfaction
est d'avoir pu ramener au camp 600 hommes du commando Martha, au complet, à la
fin d'une marche épuisante de 100 km effectuée en quatre jours... J'ai eu une chance, nous disait-il en 1994, c'est d'être sous la surveillance du SS
Friedrich Harz, un instituteur de 46 ans, entraîné contre son gré dans la
tourmente nazie, qui fit tout ce qui était en son pouvoir pour aider les
déportés. À mon retour, tout le monde était contre les Allemands, et c'était
bien normal. Mais je peux témoigner, sans lui nous ne serions pas tous rentrés.
» Tous les détails de cette période douloureuse ont été consignés
dans un journal et des carnets. Erling Hansen ne quittera le camp de Buchenwald
qu'avec les derniers détenus. C'était le 26 avril 1945.
Lors du centième
anniversaire de la naissance de Louis Guilloux, il retrouve à Saint-Brieuc
l'écrivain, ancien ministre espagnol, Jorge Semprun. L'auteur de L'écriture
ou la vie fut l'un de ses camarades de déportation à Buchenwald.
Pilier de
l'Eglise réformée, il a effectué un travail de titan pour retrouver la mémoire
de la paroisse née en 1906. Son travail a débouché sur un album. André de
Kerpezdron y a collaboré.
La
cérémonie religieuse sera célébrée au temple de l'église réformée de
Saint-Brieuc, 3, rue Victor-Hugo, lundi, à 15 h.
Les associations de résistants et déportés s'associent à la douleur des proches.
La municipalité de Saint-Brieuc organise plusieurs manifestations en 2015 pour les 50 ans de la libération des Camps de concentration.
L'évocation de la vie du docteur Hansen est un temps fort de ces célébrations.
Lors d'une cérémonie officielle, une plaque à sa mémoire est apposée sur sa maison à St Brieuc en 2015.
Texte complet de l'article du 27 mai 2015 illustré par la photo ci-dessus.
L'histoire
Né au Légué, de parents norvégiens, ancien
élève du lycée Le-Braz de 1921 à 1929 et docteur en médecine, le Dr Erling
Hansen exerce place Saint-Michel. C'est là, à 7 h, le 2 novembre
1943, qu'il est arrêté par les Allemands.
Son tort ? Le Dr Erling Hansen l'expliquait
ainsi : « J'apprenais aux jeunes gens affectés d'office au Service du
travail obligatoire (STO), comment se plaindre de fausses affections dont
j'attestais la réalité sur le certificat médical que je rédigeais en leur
faveur, car ils devaient après ma visite, subir le contrôle d'un médecin
allemand. Et d'ajouter, non sans humour : C'étaient vraiment de
beaux certificats de complaisance ! »
Torturé par la Gestapo, il est par la suite
déporté à Buchenwald puis à Mühlausen. « Son statut de médecin et un
surveillant, un Allemand, instituteur francophile, lui ont permis d'éviter le
pire », a rappelé hier son fils après avoir dévoilé, en compagnie de Bruno
Joncour, une plaque au 28, place Saint-Michel. « Toutes ces raisons lui ont
permis d'en réchapper mais aussi de sauver la vie de nombreux détenus qui lui
furent confiés. » Comme ce jour où il ramena au camp les 600 hommes du
commando Martha, au complet, à l'issue d'une marche épuisante de 100 km
effectuée en quatre jours.
« Il incarnait parfaitement les
valeurs de l'humanisme, a
pour sa part salué Bruno Joncour : Intellectuellement,
spirituellement, physiquement, pratiquement. » Dr Erling Hansen était de
ces Médecins de l'impossible dont Christian Bernadac a tiré un livre.
Des hommes et des femmes qui virent, plus que quiconque, l'horreur se figer au
plus profond de la chair. Hansen quittera Buchenwald le 26 avril 1945
avec les tout derniers détenus. Il s'est éteint à Saint-Brieuc en 2008.
 |
Plaque commémorative sur la maison d'Erling Hansen,
place St Michel à St Brieuc (photo RF) |
 |
| Erling Hansen en 2008. Photo famille Hansen |
Médecin de l'impossible
Ci-dessous, cet article a été publié le 15 novembre 1968 à l'occasion de la sortie du livre Médecins de l'impossible de Christian Bernadac.
L'histoire du docteur Hansen y est évoquée.
 |
15 novembre 1968 Ouest-France
|
Transcription de l'article du 15 novembre 1968
Grâce à un
médecin briochin, les 600 déportés d’un camp de concentration revinrent tous
vivants
Dans
les « Médecins de l'Impossible », consacré aux témoignages de 80 médecins
déportés, notre confrère Christian Bernadac cite un cas unique dans les annales
de la déportation : aucun décès ne fut constaté à Mühlausen, dépendant du
sinistre camp de Buchenwald.
Six cents déportés affectés au commando de « Martha
» ont résisté, onze mois durant, à la maladie. Malgré la sous-alimentation, malgré
un travail pénible dans une usine d'armement, malgré aussi des sévices, tous
étaient vivants, sinon en bonne santé, en avril 1945, à l'arrivée des troupes
américaines.
Beaucoup
devaient d'être encore en vie au médecin du camp.
Ce
médecin était un déporté briochin, le Dr Hansen, actuel président de l’A.D
.I.F. dans les Côtes-du-Nord. Le Dr Hansen nous a garanti l’authenticité de ce
récit à peine croyable.
« Pendant
de longs mois, j’ai tenu à jour à Buchenwald, puis à Muhlausen, mon cahier de
déportation, des carnets que je noircissais au crayon. L’écriture s’est
altérée. Mais Christian Bernadac a pu lire les 80 pages, que je lui ai
adressées, avant de rédiger le chapitre concernant Muhlausen ».
Le directeur de
l’usine voulait des hommes valides.
Avec
16 autres résistants, dont le pasteur Crespin et le commandant Vallée, le
docteur avait été arrêté à son domicile le 2 novembre 1943. Le dénonciateur, un
homme auquel il avait rendu service à de nombreuses reprises, a été condamné
aux travaux forcés à vie.
Après
quelques jours d’internement à Rennes, puis à Compiègne, le Dr Hansen arrivait
à Buchenwald le 20 Janvier 1944
Le
camp de Martha ne se trouvait qu’à
quelques kilomètres. Six
cent
déportés de toutes nationalités y travaillaient à !a construction d’éléments d’ailes
de Junker, les avions de la Wehrmach.
Il
fallait un médecin pour soigner ces 600 travailleurs. Les S.S
désignèrent
le Dr Hansen. Ils lui remirent quelques médicaments traditionnels, ridiculement
insuffisants.
Les
installations sanitaires étaient d'autre part inexistantes, malgré la promesse
d'installer une infirmerie dans une maison close réservée jusque-là aux
plaisirs des S.S.
Le
Dr Hansen protesta auprès du directeur de l'usine : « Les hommes ne pourront
travailler guère longtemps s'ils ne sont pas soignés. Donnez moi des médicaments
et je vous garantis que tout ira bien ».
Le
directeur de l'usine mit en cause le commandant des S .S. et fit tant de bruit
que, pour sauver les malades, le Dr Hansen bénéficia de 20 marks par mois... Il
obtint même l'autorisation de s'approvisionner à la pharmacie de Muhlausen.
« Le
commandant S.S dont j’étais devenu le pire ennemi, me flanqua d’un
sous-officier réserviste, du nom de Hartz. Instituteur dans le civil, cet homme
âgé d'une quarantaine d'années détestait les nazis. I| avait été condamné à 3 mois
de prison pour son hostilité à Hitler, ce que devaient ignorer ses supérieurs.
Il parlait au surplus le français de façon convenable. De sorte que, préposé au
rôle de garde-chiourme, il devint rapidement mon complice ».
Un
traitement « de faveur »
Manœuvrant
adroitement, le Dr Hansen en imposa aux S.S. et fit en sorte qu'ils eurent eux-mêmes
recours à ses soins. Ceci évita aux déportés bien
des
coups et leur fit bénéficier en même temps d’un traitement peu courant dans un
camp de concentration.
Le
rapport que le responsable de l’usine avait dressé contre le commandant de
Muhlausen provoqua un contrôle des lieux.
« Martha
» obtint son infirmerie et son médecin français, le droit de se rendre en «
tram » à la pharmacie. On le chargea en outre de la surveillance sanitaire d'un
camp de femmes hongroises et polonaises déportées, elles aussi, à Muhlausen.
Ces
déplacements lui permirent d'entrer en contact avec plusieurs membres du
Deuxième Bureau qui s'étaient glissés dans un groupe
du
S .T.O. Ceux d'entre-eux qui ne connaissaient pas le toubib français
l'identifiaient par le couvre-chef (un béret basque) du Dr Hansen.
Davantage
que des soucis humanitaires, la peur d'un rendement insuffisant, et donc de
déplaire, animait probablement le directeur de l’usine.
Mais
qu'importe ! Le médecin briochin avait obtenu gain de cause sur toute la ligne.
Les sulfamides, qui venaient de faire leur apparition, lui permirent de guérir
bien des affections pulmonaires.
Des
ulcéreux de l’estomac reprirent espoir. II put amputer des accidentés. Des malades
purent recevoir des fruits vitaminés. Bien mieux, quelques autres furent admis
à l'hôpital civil de Muhlausen.
Et
chose ignorée, des S.S du camp, plusieurs civils sollicitèrent les soins du médecin
français !
Le 4
avril, à l'approche des Américains, le commando réintégrait le camp de Buchenwald
où les alliés faisaient leur entrée une semaine plus tard.
La
plupart des déportés furent rapatriés entre le 12 et le 15 avril
Le
Dr Hansen demeura au chevet des malades Jusqu'à la fin du mois.
Les
carnets de captivité avaient échappé aux fouilles des S.S grâce à la vigilance
de l'homme qu'ils avaient affecte à la surveillance du médecin.
Le
sous-officier Hartz entretint, la guerre terminée, une correspondance suivie
avec le Dr Hansen.
Mme
Hartz a annoncé, il y a quelques années, le décès de son mari.
La
vigilance des nazis avait été déjouée dans le camp même dont ils avaient la
responsabilité. L'homme en qui ils plaçaient leur confiance les avait trahis.
Les
600 déportés de Muhlausen revinrent vivant. Ce qui comptait bien plus.
Y.
Le Gac
Un témoignage
Gilles Rivière, né dans les années 50, conserve un souvenir amusant d'Erling Hansen :
"Erling Hansen, c'est le docteur qui m’a fait venir au monde. Comme pour ma mère bien bretonne, peu habituée aux noms étrangers, ce docteur avait "un nom à coucher dehors", elle disait simplement "Le grand docteur". Une fois, on l'a croisé dans le Passage de la Poste, elle l'a salué et elle m'a dit : "Tu vois, c'est "Le grand docteur", c'est celui qui t'a mis au monde"... Sauf que, comme toute bretonne, elle avait du retard pour m'expliquer les secrets de la vie et du coup, je n'ai pas bien compris alors ce qu'avait vraiment fait ce grand docteur ! "
Gilles Rivière, novembre 2023
Le saviez-vous?
Erling Hansen était passionné par la culture bretonne et il était adhérent du Cercle Celtique du Penthièvre qui avait une très bonne réputation dans la région de Saint-Brieuc et bien au-delà. Il organisa une tournée du Cercle Celtique en Norvège en 1954. Roland Tostivint, un autre membre de la paroisse sera de cette expédition.
Voilà comment Roland Tostivint raconte cette aventure dans l'édition de Ouest-France du 6 mars 1992 : "Je
ne connais rien à la musique. En 1954, le docteur Hansen m'a embarqué
pour un voyage en Norvège. Avec Bernard Gauçon de Langueux, nous avons
donné une représentation quotidienne pendant un mois avec un programme
qui comportait cinq airs !" (voir l'article sur Roland Tostivint en cliquant ici)
Sources